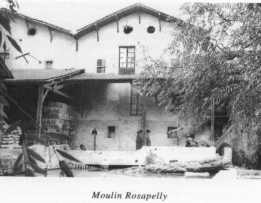par ALAIN LAGORS professeur
d'histoire,membre de la Société Archéologique et historique du Gers et
Plaisantin.
J-F Bourdeau
évoque non seulement les riches potentialités agricoles de la vallée, mais aussi le
caractère particulièrement soigné de son agriculture (51) :
• Saint Aunix : « cette
petite commune est fertile et bien cultivée et s'occupe d'élevage et d'engrais des
animaux ».
• Cahuzac : « la commune
est citée comme une de celles qui, dans le pays, s'occupent avec le plus de soin
d'agriculture ».
• Galiax : « bonne
agriculture, élevage soigné, excellente commune qui a produit au concours départemental
d'Auch en 1860, les spécimens de l'espèce chevaline honorés des premiers prix ».
• Préchac : « c'est un
village très bien bâti sur la rive droite de l'Adour et le canal d'Alaric au milieu de
campagnes fertiles, agréables et cultivées avec soin ».
• Tasque : « excellente
terre à blé ».
• Plaisance : « la plaine
environnante déjà naturellement favorisée sous le rapport de l'agriculture, verra
bientôt s'ouvrir pour ses producteurs une nouvelle source de richesse. Elle va posséder
un canal d'irrigation dont M. Granier de Cassagnac a obtenu la concession
J-F Bourdeau
souligne également la qualité des vins rouges des communes de Cannet et de Goux et
l'importance de l'élevage du cheval dans les communes riveraines de l'Adour de Ju-Belloc
et de Tieste.
La richesse des campagnes de la
Rivière-Basse de la fin du XVIII, siècle au début de la Ill, République a laissé sa
marque dans le bel habitat rural des villages de la vallée. Le fronton angulé qui
couronne la façade principale des habitations et les très surprenantes baies de forme
ogivale qui percent les murs de certaines granges à arceaux de briques en sont sûrement
les symboles décoratifs.
5) - Un
bourg-marché, entrepôt des vins et des grains, en expansion
Plaisance appartient par sa taille
de bourg-marché de 2000 habitants mais surtout par le petit nombre de ses foires
annuelles et ses marchés bimensuels (52) du lundi à la catégorie des places centrales
secondaires des pays du Moyen-Adour. Mais elle n'en reste pas moins, pendant tout le XIX,
siècle, un important centre du négoce des vins et des grains du piémont
pyrénéen.
Qualifiée dès l'An XI comme l'une
« des plus commerçantes du pays », elle est pendant la plus grande partie du siècle un
entrepôt des vins et des céréales pour le Béarn et la Bigorre (53). Le commerce
des vins et eaux-de-vie, très important dans la première moitié du siècle est
supplanté par le négoce des céréales après la crise de l'oïdium (1852) (54). Ce
dernier a fortement marqué l'urbanisme plaisantin à partir de 1840, puisqu'il est non
seulement à l'origine de l'édification de la vaste place aux Grains, mais aussi du
renforcement de l'activité minotière avec la construction à la fin du Second Empire des
deux nouvelles minoteries Cassagnac. Au début de la Ille République, la gare de
Castelnau est le débouché des quatre minoteries du bourg dont les produits se répandent
dans les quatre départements limitrophes (55). Le négoce des vins anime encore le
bourg-marché pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle. On voit même sous la Ille
République, les Beustes (56), gros marchands de vins, quitter la vieille ville pour
établir leur habitation, magasin et vaste cave dans le nouveau faubourg, à deux pas de
la place nouvelle, centre du négoce des denrées agricoles. Trois nouveaux tonneliers
s'implantent d'ailleurs à Plaisance entre 1856 et 1881 et quatre sont encore en activité
dans les faubourgs de la ville en 1882. Mais les minotiers, considérés dès le début de
la Ille République comme les « industriels » du bourg, tiennent dès lors le haut du
pavé.
Le commerce du bétail se développe
pendant tout le siècle. Une foire aux boeufs gras pour la Toussaint existe déjà sous la
Restauration. Les agrandissements successifs du foirail en 1831, 1855 et 1883, établi
sous le Premier Empire sur les bords de la rivière(59) mais aussi l'implantation dans le
bourg d'un « conducteur de corné » (1845), de marchands de bestiaux, et d'un éleveur
de chevaux (1868) (60) témoignent d'un négoce en expansion.
La croissance du bourg-marché tout
au long du XIX, siècle se traduit par
• l'importance des
aménagements de places à vocation commerciale et leurs agrandissements successifs
(61);
• l'implantation à Plaisance
entre 1849 et 1872 de six nouveaux sabotiers (62);
• l'installation à la fin du
Second Empire et sous la Ille République d'hommes d'affaires et d'une banque (63) ( le
Crédit Foncier français) assurant l'encadrement financier du négoce, ce qui témoigne
de l'importance des affaires traitées.
Les foires et marchés
atteignent leur apogée dans les années 1880. On cherche, en effet, à agrandir encore et
le foirail et la place Nouvelle devenus trop exigus (64) . La municipalité projette même
l'édification d'une vaste place au coeur de la vieille ville(65). Les remises
apparaissent en grand nombre (66) à partir de 1875 pour pallier les inconvénients des
embouteillages des rues et places par les chars, charrettes et voitures les jours de
marchés et de foires. C'est vers 1880 que les activités du négoce font l'objet d'une
distribution spatiale rigoureuse à l'intérieur du centre ville : « sur la place
Nouvelle : le négoce des vins et des céréales; sur la place Vieille : les marchands
forains et le marché aux légumes; sur la place Saint Marsault (ou du Pont) : la vente de
la volaille, du gibier et des oeufs, rue de la Mairie les oies, les oisons et les petits
canards; aux Allées ( au bout du pont) le marché au bois de chauffage; au foirail :
veaux, gros bétail, chevaux, juments, mulets, ânes, porcs, porcelets, brebis, moutons »
(67) .
L'aspect ludique
des foires s'affirme très nettement dès le début de la IIIe République. Apparaissent
alors un jeu de quilles, une salle de danse et même un billard (68), ce qui témoigne de
la fréquentation grandissante des foires et marchés de Plaisance par la jeunesse des
villages de Rivière-Basse.
6) - Un tissu artisanal et
industriel renforcé
Le bourg-marché,
centre des échanges des productions agricoles, est aussi un lieu de fabrications
artisanales et industrielles. Nous avons vu précédemment comment l'immigration au XIX
siècle a renforcé le tissu artisanal plaisantin qui reste d'ailleurs très puissant
jusqu'aux années 1880 (69)
Le négoce, né
de la route, induit des activités de productions artisanales et industrielles. Le
commerce des grains, par exemple, si important à partir de la Monarchie de Juillet, a non
seulement fortifié l'activité industrielle par l'agrandissement des vieux moulins à eau
et par la construction de deux nouvelles minoteries, mais il a renforcé aussi dans le
bourg la représentation de certains métiers (garçons meuniers, grainetiers, rouliers,
charrons, carrossiers) et induit de nouvelles professions (architecte et charpentiers
d'usines, rhabilleurs et piqueteurs de meules). De plus, la construction des moulins et de
la place aux Grains a attiré de nombreux professionnels du bâtiment de la région.
Comme
beaucoup de bourgs-marchés de la Gascogne, Plaisance demeure jusqu'à la Belle Epoque une
pépinière d'artisans. C'est le long de l'Arros et des deux canaux de la commune que se
développent au cours du siècle les petites entreprises industrielles contribuant à la
prospérité de Plaisance au XIX' siècle. L'activité du cuir, si florissante dans la
bastide sous l'Ancien Régime perdure pendant tout le XIX siècle, par la création en
1849 et l'agrandissement en 1883 de la grande tannerie Verdier-Pomiro sise sur les bords
de l'Arros, dans le quartier des Péjous (70).
L'industrie textile se
présente sous deux formes - le travail à domicile des nombreux artisans des faubourgs
mais aussi dans le cadre d'une carderie-filature (71) créée sous le Second Empire dans
le vieux foulon, construit au début du siècle par Henri Saint-Pierre Lesperet sur le
canal d'amenée du moulin de l'abbaye de la Case-Dieu. Une industrie teinturière s'y
greffe à la même époque (72). o
Comme nous
l'avons vu précédemment, c'est à partir de 1863 que l'activité minotière se renforce
par la construction des moulins Cassagnac et par les agrandissements des moulins du Tilhet
et Rosapelly. Deux scieries s'implantent sur les deux canaux de la ville au début de la
IIIe République (73). Les premières batteuses (fixes) utilisant chutes de bois et
copeaux s'y intègrent peu de temps après(74). En 1893, Léonce Rosapelly, au retour de
l'Exposition Universelle, crée l'une des toutes premières usines
électriques de la Gascogne (75) en équipant la carderiefilature de la dynamo de
Gramme. Mais cette création intervient dans un bourg certes électrifié très tôt, mais
déjà en crise
(51) Il n'évoque pas l'agriculture des communes de coteaux : Lasserrade, Couloumé-Mondébat et Beaumarchès.
52) A.M Plaisance, Mercuriales des prix. Jusqu'en 1886, les marchés se déroulent tous les 15 jours le lundi alternativement avec Aignan. Les cinq grandes foires ont lieu : le premier lundi de Janvier, le jeudi qui précède Rameaux, le 23 mai, le 28 août et le 29 octobre...En 1886, le marché devient hebdomadaire et se déroule le jeudi.
53) Délibérations communales
(1811-1838) ... op. cit., séance du 20 Août 1826: « Plaisance par sa position
topographique est l'entrepôt où les habitants des départements des Hautes-Pyrénées,
Basses-Pyrénées et Landes viennent s'approvisionner en blé, avoine et autres
denrées... » -, Vaysse de Villars...op. cit., 1830, « son commerce consiste en grains,
vins et eaux-de-vie » ; Dominique Vincent... op.cit.; 1943, Leur commerce consiste en
vins et en céréales dont elle alimente le Béarn et la Bigorre.
(54) J-F Bourdeau, Manuel de
géographie historique... op. cit., « Avant l'irruption de l'oïdium dans la contrée,
où cette maladie a exercé les plus affreux ravages, les négociants de Plaisance
faisaient beaucoup d'affaires sur les vins. La place continue à être abondamment pourvue
en grains, légumes et autres productions du sol ». Sept marchands de vins vivent à
Plaisance au début du XIX, siècle : François Bazerque, les deux frères Bonnafont,
Laffite, Palan, Lapèze et Vives (extrait des actes de naissances de l'An XI, XII, XIII).
Etat civil. Plaisance. A noter l'apparition sur le marché de Plaisance de la pomme de
terre en 1869 et der, haricots en 1855.
(55) Délibérations communales
(1865-1894) op. cit., séance du 13-05-1866.
(56) Aujourd'hui Maison
Soubiran.
(57) Un originaire de Balirosq
(Basses Pyrénées) 1856 ; un originaire de Laméac (Hautes Pyrénées) 1862; un
originaire d' Aubous (Canton de Garlin, Basses Pyrénées).
(58) Délibérations communales
(1911-1838).-op. cit., séance du 29 oct 1931.
(59) Délibérations communales
(1811-1938) op. cit., (séance du 28-11-36). Matrice cadastrale du Plan de Plaisance,
année 1856, Diminutions: converti en champ de foire. Délibérations communales
(1865-894).-op. cit.. séance du 18-8-99.
(60) Il s'agit de Maignon
Ernest.
(61) Voir Infra, la croissance
urbaine.
(62) Ils ont originaires de Viella,
Beaumarchès, Castelnavet (Gers), Castelnau et Lourdes (Hautes Pyrénées) et un de la
Charente inférieure.
(63) 1868 : Lacay, banquier à
Tarbes; 1875 : Dessens, banquier à Marciac; 1885 : Crédit Foncier de France - Matrices
cadastrales.
(64) Délibérations communales
(1865-1894) ... op. cit., séances du 10-08-1979 et 29-11-1883.
(65) Idem séance du
10-11-1887.
(66) Matrices cadastrales ... op.
cit.
(67) Délibérations communales (1865-1894) ... op. cit., séances du 18-09-1879 et 06-10-1881.
(68) Matrices cadastrales,... op. cit., 1868 : St Lanne ouvre un billard; 1878 : Paul Laborde, perruquier ouvre une salle de danse; 1975 : Joseph Labadie, cafetier, crée un jeu de quilles.
(69) Les artisans représentent 48% des professions portées sur les matrices cadastrales de 1882 et 23% des 552 propriétaires répertoriés.
(70) Matrices cadastrales
... op. cit., Volume n°1. En 1886 Jean Thounon domicilié au foirail est tanneur.
(71) J-F.. Bourdeau, Manuel de
géographie historique ... op. cit.,: on y remarque une carderie-filature qui fonctionne
encore en 1897 puisque Léonce Rosapelly déclare, en 1897, année de forte inondation, la
perte de 120 kg d'huile à carder. A.M., Inventaire des dégâts causés par l'inondation.
1876 : Capdeville est cardeur au faubourg Ste Quitterie.
(72) Jean et Nicolas Rosapelly
sont teinturiers en 1928 (matrices cadastrales vol n°1 Deux nouveaux teinturiers
s'implantent en 1851 et 53 (Etat Civil, Mariages). Quatre sont répertoriés sur les
matrices immobilières de 1882.
(73) Portées sur la carte Chanche, 1883.
(74) Portées sur la carte
Chanche, 1883.
(75) Matrices cadastrales op. cit.
Délibérations communales (1865-1894)... op. cit., séance du 1611 - 1892: contrat
d'électrification de la ville passé entre la municipalité et Rosopelly Léonce,
négociant