par ALAIN LAGORS, professeur d'histoire, membre de la Société Archéologique et historique du Gers et Plaisantin.
Sur le plan de 1826, le nouvel espace urbain modelé par la grande route présente les trois caractères suivants :
• un étirement de l'agglomération du Nord au Sud sur plus d'un kilomètre et demi :
• la disproportion entre la bastide très étriquée (superficie de 2,5ha) et le faubourg Sainte Quitterie immense qui s'étend le long de la route :
• l'effacement progressif du paysage ancien de la bastide avec la destruction des portes, de la halle, de l'église Saint Nicolas et des maisons à pans de bois.
La grande route des Pyrénées a bien transformé dans le premier tiers du XIXe siècle Plaisance en « bastide-route ».
Il - 1837-1875 : LA NAISSANCE DU FAUBOURG DE LA «
GRAND RUE » ET DE L'ÉGLISE ET LES RÉAMÉNAGEMENTS DE LA VIEILLE BASTIDE
« Puissent le mouvement de sa
population et le développement de son commerce féconder ce désir d'agrandissement qui
la tourmente » écrit Dominique Vincent en 1843.
1) - Le nouveau faubourg
De
1837 à 1875, durant quarante ans, Plaisance devient un énorme chantier : on y construit,
en effet, un monumental pont de pierre, on y édifie un vaste faubourg qui se structure
autour d'une nouvelle place à arcades et d'une vaste église, toute neuve, on y creuse un
canal d'irrigation qui alimente deux minoteries modernes! Mais on continue toujours à
réaménager la vieille ville.
a) - Les promoteurs
Le nouveau
quartier en construction à partir de 1837 dans la zone des jardins et prés dite « à
Mounat », à l'ouest du noyau urbain ancien, n'est pas né d'un plan préconçu. Il est
le résultat d'un urbanisme pragmatique fait d'aménagements successifs, créés au gré
des éventuelles possibilités d'achats de terrains à allotir, du coût des équipements
à construire et qui prennent jour souvent après bien des tergiversations des édiles
locaux. Ce sont les municipalités qui guident, stimulent l'extension urbaine de la petite
cité, achetant les terrains nécessaires à l'extension du bourg, lotissant les nouveaux
espaces à occuper. Mais les conseillers municipaux ont souvent trouvé un écho favorable
auprès des particuliers qui offrent parfois gratuitement -ou à des conditions
avantageuses de paiement- les terrains nécessaires à l'extension projetée (102).
PLAISANCE VOLS 1880
Cliquer pour agrandir
Certains habitants du lieu ont, par leurs initiatives, favorisé la croissance urbaine de leur cité. De 1854 à 1865, la veuve Ducuing née SaintPierre Lesperet transforme les terres agricoles de sa métairie de Lalanne, proches de la nouvelle place aux Grains, en lotissement populaire. Elle y édifie pendant une dizaine d'années vingt cinq maisons (103), toutes identiques, ressemblant à un petit « coron artisanal » qu'elle loue aux artisans nouvellement implantés dans le bourg.
b) - Les
mobiles
Trois impératifs présidèrent à
la construction du faubourg:
*La nouvelle extension
Est-Ouest de la cité casse l'étirement NordSud de l'agglomération le long de la grande
Route des Pyrénées et rééquilibre ainsi l'espace urbain ;
• le quartier créé,
plus citadin par son organisation de l'espace et ses équipements que le faubourg Sainte
Quitterie, double la vieille bastide, contribuant à renforcer le « centre-ville » et
donner à Plaisance un visage plus urbain ;
• il renferme aussi le grand
équipement commercial de la cité de la Monarchie de Juillet: la place aux Grains. Il est
conçu pour la circulation et le commerce d'un bourg-marché en pleine expansion vers
1850.
2) - Les étapes de
l'urbanisation du faubourg (1837-1875)
L'urbanisation du
quartier créé dure une trentaine d'années (18431875) et se fait en plusieurs étapes.
Alors que la
route de Préchac, axe de la nouvelle expansion urbaine, est percée dès 1837 (104), les
premières constructions n'apparaissent qu'en 1843. Ces six ans de battement font dire à
Dominique Vincent : « On a commencé naguère la construction d'une nouvelle place qui
sera peutêtre longtemps déserte ». Mais, à partir de 1843, l'occupation du
faubourg s'affirme, lentement toutefois, jusqu'en 1853. Durant cette décennie, il
n'accueille qu'une vingtaine de constructions (24) dont les dix premières sont édifiées
en majorité par des professionnels du bâtiment, devenus premiers propriétaires du
nouveau quartier. De 1854 à 1864, le mouvement s'accélère puisqu'on y construit une
cinquantaine de maisons. L'édification au coeur du quartier de la nouvelle église dont
les travaux débutent en 1854 mais aussi l'opération immobilière de la veuve Ducuing qui
voit le jour aussi à cette date contribuent au succès de l'opération urbaine (105).
Dès 1861, le
faubourg de l'église bien qu'encore inachevée est bien dessiné. F.J. Bourdeau l'évoque
ainsi en 1861 : « On y remarque une nouvelle église paroissiale, en construction, en
ce moment la place aux Grains avec ses maisons latérales et parallèles et leurs longues
galeries à arceaux continus, terminée à l'est par le nouveau monument religieux »
L'urbanisation se prolonge encore pendant une décennie jusqu'en 1874, mais à un rythme
ralenti : trente quatre constructions y sont édifiées. Mais on reconstruit et on
agrandit les maisons existantes, ce qui témoigne de la réussite de l'opération urbaine
mise en place sous la Monarchie de Juillet et de l'enrichissement rapide de beaucoup
d'habitants du quartier. A partir de 1875, le mouvement se tarit car la croissance
démographique trop faible ne le soutient plus
3) - Le
plan (106)- la voirie
Le nouveau
quartier de forme trapézoïdale et de direction générale est-ouest couvre une
superficie de 10 hectares, soit environ quatre fois et demi celle du noyau ancien. Greffé
sur le chemin de grande communication de Plaisance à Conchez par Viella, ouvert en 1837,
le nouvel -espace urbain s'étire le long de la route de Préchac, dont la portion
urbanisée dans le faubourg devient très vite la rue Adour ou Grand Rue. Axe de la
nouvelle expansion urbaine mais aussi trait d'union entre la Place Vieille et la Place
Nouvelle, elle devient dès le début de la III, République, l'une des rues les plus
animées de la cité. Le nouveau quartier reprend l'aspect régulier du plan de la bastide
vieille.
Son
tracé s'organise le long de trois longitudinales de direction EstOuest : route de
Préchac ou rue Adour au Nord, rue Saint Nicolas au centre qui constitue l'axe de
symétrie, vieille route de Castelnau au sud ou rue de la fontaine. Elles débouchent,
toutes trois, à l'ouest sur le nouveau chemin de grande communication, ouvert en 1852,
qui file droit sur Belloc, appelé aussi route de Barbat. Celle-ci constitue la limite
occidentale du nouveau quartier. Quatre transversales les recoupent orthogonalement
délimitant huit îlots bâtis, le plus souvent de forme rectangulaire mais de dimensions
différentes. La forme trapézoïdale des îlots occidentaux est due au tracé oblique de
la route de Barbat de direction Nord-Ouest Sud-Est. L'îlot central se subdivise en deux
sous-espaces. L'un compris entre la rue Adour et la rue Saint Nicolas, le premier
aménagé, renferme la place aux Grains. L'autre qui s'étend au sud de ce dernier est
occupé par l'église et un vaste « patus ».
Par son
tracé, le nouveau faubourg rappelle les bastides de structures linéaires conçues pour
la circulation. Le plan du nouveau quartier rappelle en plus aéré, plus spacieux celui
du noyau ancien.
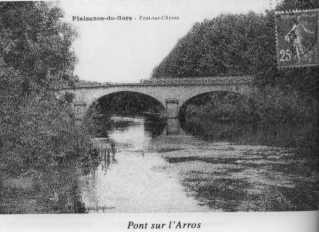
4) - La place aux
Grains ou place Nouvelle
Edifiée entre 1843 et 1849 (107), la place aux Grains couvre une étendue d'environ 20
ares et demi, soit une fois et demi la vieille place. Elle est encadrée à l'est et à
l'ouest par deux îlots de maisons bâtis sur arcades très régulières de pierre. Elle
est née du projet commercial de la municipalité de la Monarchie de Juillet qui recherche
un vaste espace pour y ériger une grande halle aux grains. Dès 1834, les carrières de
Mondébat et de Croute fournissent la pierre nécessaire à la construction de l'édifice
(108). Mais, ce premier projet, jugé trop onéreux, est abandonné et est remplacé en
1842 (109) par un nouveau plan de coût plus modique, permettant d'associer à la fois les
objectifs commerciaux et d'urbanisation d'un bourg-marché en plein expansion. Il
abandonne, en effet, le projet de la construction d'une vaste halle aux grains et réduit
les dimensions de la place. L'espace restant est alloti, vendu mais aussi concédé en
partie gratuitement aux nouveaux propriétaires qui s'engagent à construire selon un plan
donné : des maisons à arceaux. Les longues galeries latérales édifiées qui occupent
les parties des lots concédés gratuitement deviennent un espace public destiné au
marché aux céréales. La municipalité a ainsi économisé les frais occasionnés par
l'édification d'une vaste halle aux grains, tout en favorisant l'occupation de la
nouvelle place par les conditions d'installation avantageuses offertes aux nouveaux
propriétaires. La place aux Grains, par son aspect monumental, contribue aussi à
l'embellissement de la cité. Elle prend très vite le nom de place Nouvelle pour la
distinguer de la place Vieille du noyau urbain ancien dont elle a repris l'architecture à
arceaux.
Au début
de la IIIe République, elle devient trop exiguë vu la fréquentation toujours
grandissante des foires et marchés de Plaisance. La municipalité envisage alors, en 1883
(110) , son agrandissement et même de parfaire son architecture en prolongeant vers le
sud, par la construction de nouvelles maisons à arcades, ses deux galeries latérales qui
devaient constituer un écrin de pierre à l'église toute neuve. Ce projet monumental
trop tardif ne voit pas le jour, du fait de la crise du bourg à la Belle Epoque.
(102) Délibérations
communales cit., séance du 28-05-1834: "Monsieur François Laffeuillade
négociant, membre du conseil municipal avec lequel monsieur le maire a traité, a offert
de donner pour l'ouverture de la route de Préchac une somme de 1500 francs et de fournir
gratuitement le sol nécessaire ; séance du 11-11-1842 : « le terrain pour la
construction de la Place nouvelle sera payé à monsieur Laffeuillade dans les cinq ans et
cinq paiements égaux », KM Plaisance, Registre de la fabrique de la paroisse Sainte
Quitterie de Plaisance, séance du 05-06-1953 : « L'abbé Bonnafont donne à la
municipalité le jardin qu'il possède au sud de la place Nouvelle pour l'édification de
la nouvelle église ».
(103) Matrices cadastrales.... op.
cit., 1° volume, Augmentation de 1854 à 1865
(104) Matrices cadastrales....
op. cit, 1837, Diminutions : destruction de la grange de Barthelemy Olleris pour
l'ouverture de la route de Préchac. La pierre sculptée portant le millésime 1837,
incluse dans la façade de la pharmacie Labadie rappelle la date de l'ouverture de la
route de Préchac.
(105) A.D., 6M 146, canton de
Plaisance, 1856 : le recensement dénombre 20 maisons à « place neuve » occupées par
27 ménages (l 14 habitants). Une rue du faubourg appelée « angoync » (Grande rue?) est
bordée de 30 maisons habitées par 33 ménages (112 habitants). En 1856, la population du
faubourg dépasse les 200 habitants : 21 maisons sont construites entre 1854 et 1856.
(106) Voir plan de Plaisance vers
1880: organisation spatiale du bourg-marché à son apogée.
(107) A Maubourguet en 1836 on
édifie aussi une vaste place aux Grains.
(108) Délibérations communales
(1811-1838).... op. cit., séance du 28-05-1834: « la pierre nécessaire à la
construction de la halle aux grains, se trouvait extraite, savoir la pierre de taille aux
carrières de Mondébat et le moellon dans celle de Croute... ».
(109) Idem, séance du 11-12-1842
(110) Délibérations communales (1865-1894).... op. cit., séance du 29-11-1883: « les terrains avoisinants l'église et appartenant à la commune seront aliénés ( ... ) à la charge des acquéreurs d'élever sur ces terrains des constructions conformes à celles qui entourent la place... »